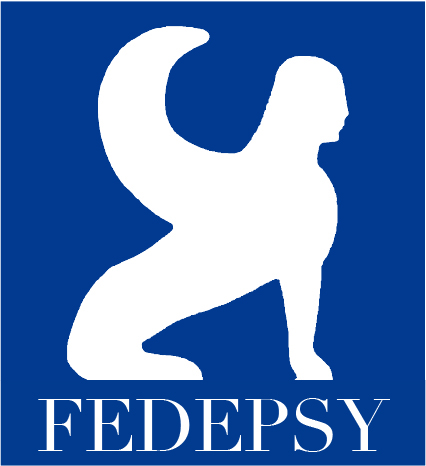L’expérience nous a montré que les analysants pris dans le transfert analytique, où le sujet est pris dans l’ordre du langage, branché sur la dimension du sujet supposé savoir, n’étaient pas étouffés par les discours universels avec leur accumulation de sens, complotistes en l’occasion. Ce qui n’a pas empêché l’exacerbation des difficultés subjectives, des lignes de fragilité propres à chacun, liées aux incidences concrètes de la vie de tous les jours. Cela amènerait-il à penser que les paramètres mis en jeu dans l’analyse protégeraient des phénomènes de certitude ?
De l’Unglauben à la croyance
Lacan est donc parti de son expérience de la psychose, avec l’Unglauben, ce rapport particulier de l’homme à son monde, soit ce rapport d’un sujet directement branché sur l’Autre plein, sans faille, sans cesse là avec des exigences insupportables, capable de faire de la personne une marionnette. L’expression ultime en est l’automatisme mental ; un discours qui marche tout seul, où le sujet entend sa propre pensée, reflet de ce que le langage est une « machine » qui traverse le sujet, machine qui le nourrit en même temps que le sujet l’entretient.
C’est à partir de là que Lacan opère la ségrégation entre névrose et psychose. Le névrosé éclaire ce lieu de l’Autre qui est un Autre barré, noté S(A), à savoir que dans sa demande adressée à l’Autre, à l’analyste en l’occasion, (de le guérir, de le révéler à lui-même), le sujet ne rencontre que la demande de l’Autre ; « il me demande… ». Si l’Autre intéresse tant le névrosé, c’est qu’il veut savoir ce qui lui manque à l’Autre, quel est son désir. Cette faille en l’Autre, il n’y a pas pour l’analyste à essayer de la combler par un savoir, une interprétation qui donnerait du sens, ce qui ne serait qu’une fermeture de l’inconscient. Ce serait établir une relation de maître ou d’enseignant qui dicte l’endroit où le sujet doit se loger, soit la pulsion de mort en exercice. Au contraire, cette faille, il y a à la faire fonctionner comme cause, cause du savoir par la production de signifiants à travers le défilé de la parole.
Le seul vrai choix pour le sujet, c’est cette dimension du tragique. À entrer dans le défilé des signifiants, le sujet ne peut trouver le dernier mot, car aucun mot ne fera réponse à sa demande. Ce signifiant de grand A barré n’est pas simplement une limite ; il est la condition de la parole et du désir. Il faut pour cela un opérateur, une référence qui assure que l’Autre est barré. Le Nom-du-Père est ce qui vient garantir l’écart entre la mère et l’enfant, entre le sujet et l’Autre.
Lacan prend acte de l’évolution du contexte culturel lorsqu’il introduit la question de la métaphore paternelle comme premier temps de l’œdipe, temps qui s’ajoute à l’œdipe freudien. Si le père primordial, jaloux et violent décrit par Freud convient au patriarcat de son époque, le père aujourd’hui apparaît faible, carent. C’est ainsi que Lacan dit à la suite de Freud :
« il est extrêmement curieux qu’il ait fallu le discours analytique pour que là-dessus se pose la question ; qu’est-ce qu’un père ? Freud n’hésite pas à articuler que c’est le nom qui par essence implique la foi[1]. »
Lacan ajoute ainsi à la lecture de Freud la foi de l’enfant en la parole de la mère, mais aussi foi de la mère en la parole du père. Cette foi instaure la métaphore paternelle ; au signifiant de son désir énigmatique pour l’enfant, la mère substitut un autre signifiant, celui du père. De cette métaphore naît une signification, le phallus, soit ce qui manque à la mère. Sans cette foi en la parole du père, la parole du père n’est que vain bavardage, futilité où l’enfant ne peut quitter sa position de phallus de la mère. Le nom-du-Père n’est rien d’autre que le père symbolique, le père mort de Totem et tabou de Freud, il introduit avec lui les diverses fonctions du père.
Le névrosé est donc fondamentalement croyant, il « y croit » à ce Nom-du-Père, croyance inconsciente, qui inaugure la croyance en un Dieu inconscient. Il y croit.
Les grandes croyances
Les grandes croyances se réfèrent aux mystères qui interpellent les humains ; origine de la vie, de la Création, de l’univers, les mystères de la mort et du sexe, soit un réel qui est un impossible à dire. Ces mystères supposent un savoir à découvrir et nous ne pouvons, c’est un fait de pensée, que le concevoir comme ordonné à quelque place[2]. Cette référence à une cause supérieure, à une transcendance détermine l’axe symbolique du langage, axe prophétique. Pour savoir, il est donc nécessaire de croire, d’accorder sa foi, d’avoir confiance dans les représentations que nous connaissons : de la religion, de la science, en passant par la mythologie ou les systèmes idéologiques.
Mais quelles emprises ces croyances exercent-elles sur nos connaissances ?
C’est-à-dire, qu’elles sont les valeurs véhiculées par ces croyances qui font référence et ordonnent nos connaissances ? Il nous faut pour cela connaître l’histoire de la science, des discours sociaux ou politique, pour y repérer les valeurs qui font références. La neurobiologie pour les neurosciences, la conception de la maladie mentale en fonction des références et des valeurs d’une époque comme la théorie des dégénérescences, ou encore l’histoire des valeurs qui légitiment certains discours actuels sur le sexe, l’identité, l’autonomie du moi.
L’Autre, comme lieu des signifiants, ne se limite pas à ceux de la famille, il est aussi celui du politique, du discours de la Cité. Ces valeurs ou références ont d’autant plus de pouvoir ou d’autorité que l’on ne sait rien de leur histoire, ni de quoi elles participent. Ne pas se noyer dans l’arbitraire des discours actuels nécessite une toilette de nos valeurs de référence. Il en est des croyances actuelles sur le sexe ou l’amour, sur la liberté. Elles sont à resituer dans le contexte philosophique où elles sont nées. Et plus particulièrement la philosophie de Bentham (1748-1832) sur l’utilitarisme qui considère l’utilité comme critère ultime, le bonheur de tous comme fin, le calcul hédoniste, l’idée insistante que « sur lui-même, l’individu est souverain » privilégiant l’idée de l’égalité et de la liberté individuelle. Cette philosophie a été reprise par les divers tenant du libéralisme – John Stuart Mill (1806-1873) ; Herbet Spencer (1820-1903) ; Milton Friedman (1912-2006) –, avant de revenir en force au cours des années 1960 et être à la base du néolibéralisme de Margareth Thatcher et Ronald Reagan dans les années 1980, puis en France dans les années 2000. De là découlent sans doute pour une part les croyances en la promotion de la liberté de l’individu jusqu’à la possibilité de choisir son sexe, la valeur accordée à une prospérité sans limite, à l’accumulation des objets à des fins de plaisirs, au refus de l’interdiction considérée comme un refus de son droit et non comme la condition de l’accès au désir, la réclamation du droit au bonheur… La méconnaissance de l’histoire de notre culture renforce l’adhésion à ces croyances partagées ; elles posent la question de ce qui détermine le sujet, le sujet de désir, mais aussi ce peut entraver l’advenu du sujet. Disons pour l’instant que la possibilité de l’écart, du minimum de distance que le sujet peut prendre avec ces signifiants, ces « valeurs », rend possible au sujet d’en limiter les contraintes.
Les petites croyances
Et puis il y a ce que l’on peut appeler les petites croyances, celles qui se rapportent aux menus événements du quotidien, ce sont les représentations imaginaires que l’on se donne de la « réalité ». On peut y repérer la croyance au père imaginaire, dans ce deuxième temps de l’œdipe où l’enfant fomente l’image d’un père jaloux, tyrannique, castrateur à la mesure de la propre agressivité de l’enfant vis-à-vis du père. C’est l’axe de l’immanence du langage, ce qui vient de la pensée du sujet, où le sujet peut se reposer de ses questions concernant les énigmes de la vie. Cliniquement, c’est l’axe du bavardage, de l’échange de platitudes et de banalités, où l’on se comprend, on se croit, où les croyances ordinaires ne sont jamais remises spontanément en cause. Position dans laquelle le sujet se trouve spontanément englué, sans concevoir ce que pourrait lui apporter le fait de parler de lui-même à quelqu’un. Ce qui apparaît lorsque certains patients nous disent lors des premiers entretiens, « mais qu’est-ce que ça change que je vienne vous parler, je pourrais le faire avec ma compagne, mon mari, un(e) ami(e)… ». Ou encore ces adolescents, « tout ce que je vous dis, je le dis à mes parents, alors qu’est-ce que ça change » ?
La question qui se pose à l’analyste, c’est de rompre avec cette compulsion à comprendre, à donner du sens encore et encore, comme une sorte de défilés de croyances qui viennent boucher les trous du discours. Tout un chacun a pu être confronté à ces patients, volontiers dans le comportement ou le somatique, qui rebondissent d’une affirmation à une autre, d’une croyance à une autre croyance, et à la difficulté d’introduire une forme d’incertitude dans ce « discours de désignation » qui ouvre à une dimension tierce, au signifiant. Soit réintroduire une dialectique entre symptôme et sinthome[3].
La question du transfert
Que le savoir soit déjà un fait ordonné quelque part, à partir d’un présupposé, c’est un fait de pensée. Einstein lui-même argue que le savoir qu’il articule se recommande de quelque chose qui est bien un supposé concernant son sujet et qu’il nomme en termes traditionnels, Dieu. Les règles du jeu existent déjà quelque part, « elles sont instituées du seul fait que le savoir existe en Dieu[4] ».
Pour le psychanalyste, le présupposé, c’est le sujet supposé savoir, dont il dit, « le sujet supposé savoir, c’est Dieu, un point c’est tout[5] ». Il est ce qui permet l’établissement du transfert. Le pari de l’analyste, c’est donc de croire qu’il y a du sujet, c’est-à-dire que derrière la parole, il y a quelque chose qui veut se faire entendre. Ce qui implique de croire à une forme de Dieu, à une forme de transcendance.
Ce sujet supposé savoir, c’est qu’il y a à la fois un sujet, et y attenant, un savoir inconscient, une suite de signifiants. Pour qu’il y ait psychanalyse, il faut cette place du sujet supposé savoir comme tiers terme entre l’analysant et l’analyste. C’est la condition pour sortir du transfert dans sa face narcissique, primaire, imaginaire, et faire l’expérience de certitude qu’il s’adresse effectivement à l’Autre, au tiers auditeur.
L’analysant peut identifier à l’occasion l’analyste au sujet supposé savoir, mais il s’agira là d’une fermeture de l’inconscient. Ce qui signifie aussi que l’analyste n’a pas à s’y identifier, il le ferait à tort. Ce que l’analyste ne sait pas du savoir inconscient supposé, il choisit de le savoir. De là l’invention de la règle fondamentale, parler, il en sortira quelque chose.
Le sujet se constitue au lieu de l’Autre, mais quel Autre ?
Le sujet ne se constitue pas à partir des discours ambiants, ce serait même aujourd’hui tout le contraire ! L’alliance du néolibéralisme et de la pensée benthamienne assujettit l’homme au marché pour devenir l’industrie du bonheur qui n’est pas sans influer profondément les croyances et les valeurs de l’individu. Cette promotion du plaisir, du bonheur, évoque l’échec du libertin dont parle Lacan dans L’éthique de la psychanalyse. Ce que les psychanalystes n’ont pu que constater dès les années 1970 à travers la montée des dits états-limites, c’est la misère psychique nommée dépression. Dépression qui se traduit non en termes d’inhibition, de honte, mais de faiblesse, d’inadéquation par rapport à l’idéal de réussite. Il s’agit ici d’absence de désir bien plus que de refoulement.
L’écoute du sujet, qui vise la constitution du sujet de la psychanalyse, doit revenir à l’infantile. Le désir de l’analyste est de renouer avec cette place du désir infantile, de manifester cette curiosité pour l’infantile. Il faut pour cela supporter qu’il y ait d’autres discours pour les traverser, avec ce point de repère que les croyances, quelles qu’elles soient, visent à recouvrir le manque avec ce besoin subjectif d’y trouver une réponse.
Il faut pour cela travailler avec la demande, donner la parole, pour renouer avec la question du manque dans l’Autre, S(A), condition du désir. La fonction de l’analyste est de soutenir la question du désir de l’Autre, du manque.
La position de l’analyste
Le désir de l’analyste, c’est de choisir ignorer ce qu’il sait déjà de son savoir référentiel. Soit une mise en suspens, la suspension du savoir et du jugement, temps qui manque dans la certitude ou la croyance. La mise en exercice du « temps pour comprendre » est reconnaissance du manque dans l’Autre qui ne répond pas à la demande, mais qui est aussi reconnaissance de la propre division subjective du sujet.
L’analyste doit-il alors être incroyant ou tout du moins soutenir cette position ? Lacan pose cette question à la fin du séminaire sur L’angoisse : « le psychanalyste doit-il être ou non athée », et est-ce que « le sujet, à la fin de l’analyse peut considérer son analyse comme terminée s’il croit encore en Dieu[6]. »
L’athée pour Lacan, n’est pas de ne pas croire en Dieu, mais il est celui qui s’affirme comme ne servant aucun Dieu. Il ne croit pas à cet œil universel posé sur nos actions, pas au fantasme d’un Dieu tout-puissant, « l’athée est celui qui a éliminé le fantasme du tout-puissant[7] ».
Il n’y a donc pas élimination de la croyance en tant que telle, en une transcendance, mais élimination de l’Autre tout-puissant. Ce qui est aussi une façon indirecte de mettre l’accent sur l’opérateur qu’est le Nom-du-Père, qui n’a d’autre consistance que symbolique.
Plus tard, dans le Séminaire D’un Autre à l’autre, Lacan reprend : « un athéisme véritable, le seul qui mériterait ce nom, est celui qui résulterait de la mise en question du sujet supposé savoir[8] ». Pas de savoir dernier, mais interrogation, mise à la question. L’Autre est l’espace marqué d’un manque, où l’on peut retrouver cette équivalence entre Nom du Père, Dieu, sujet supposé savoir. Ce qui importe, c’est la possibilité d’y croire sans qu’il y ait de réponse dernière, j’y crois sans y croire…
Pour conclure
La croyance apparaît comme une question de structure, elle est donc inéliminable. Elle est ce qui maintient l’écart, le trou, par lequel la lumière va pouvoir éclairer de façon fugace, entre deux mots, la vérité.
Ce qui amène à formuler une hypothèse ; l’expérience de l’analyse serait une sortie de la religion, une sortie du credo, cette prière qui définit les dogmes chrétiens, « je crois en Dieu, le père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre… ». Elle ouvre à une autre croyance, au Nom-du-Père, au Dieu supposé auquel « aucune existence n’est permise[9] ». Elle est cet ancrage symbolique, ce sur quoi le sujet peut s’appuyer pour que ça tienne, que tienne l’écart entre imaginaire et réel.
Ce qui pose la question de la fin d’analyse dans le dépassement de cette croyance au Nom-du-Père. Lacan nous dit que cette croyance au Nom-du-Père est dépassable à condition de s’en servir ; s’en servir, c’est redoubler la division du sujet, dont l’effet est la production de l’objet a, objet cause du désir, pour pouvoir se passer du Nom-du-Père. Ce qui conduit à la question de la croyance à l’inconscient, pas celui du sens, mais au réel de la jouissance.
Mais force est de constater avant cela, le recul actuel du symbolique au bénéfice de l’imaginaire centré sur l’Ego qui favorise l’adhésion aux croyances ordinaires. Mais aussi l’importance actuelle des paroles de certitude, de propositions venant comme d’un tout, de la multiplication de la mise en scène des dictateurs, de l’inflation des communications internet qui ne passe pas par l’Autre. La question est posée de savoir s’il est possible de renouer avec la croyance inconsciente au Nom-du-Père, soit avec la métaphore paternelle, face à des personnes sans désir, tout en exigeant un plus de jouissance.
Notre défi est de réintroduire la dimension de la parole à partir de la demande actuelle, tel est aussi l’enjeu de la psychanalyse aujourd’hui.
- J. Lacan, Le Séminaire, D’un discours qui ne serait pas du semblant, leçon du 16 juin 1971. ?
- J. Lacan, Le Séminaire, Livre XVI, D’un Autre à l’autre, Edition du Seuil, Paris, 2006, p. 280. ?
- J.-R. Freymann, Préambule au Séminaire de J.-R. Freymann, « Essai de psychanalyse appliquée, De Joyce à Philip Roth », La Lettre de la FEDEPSY, octobre 2022. ?
- J. Lacan, D’un Autre à l’autre, op. cit. p. 281. ?
- J. Lacan, D’un Autre à l’autre, op. cit. p. 280. ?
- J. Lacan, Le Séminaire X, L’angoisse, Le Seuil, Paris, 2004, op. cit. p. 357. ?
- Ibid. p. 357. ?
- Ibid. p. 281. ?
- J. Lacan, Séminaire XXIII, Le sinthome, Le seuil, Paris, 2010, op. cit. p. 136. ?