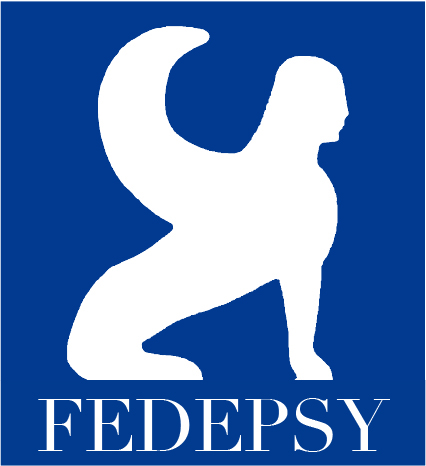Quels espaces de liberté ?
De quels espaces de liberté disposons-nous ? Nous, humains, et chacun au singulier, toi, moi, jusqu’où pouvons-nous nous mouvoir ?
L’expérience de la cure (personnelle et celle de nos analysants) dévoile à quel point le psychisme d’un humain est déterminé par des rouages qui lui échappent, mais aussi dans quelle mesure il peut s’en désaliéner.
Pascal Quignard écrit que pour l’être humain la liberté n’existe pas… La liberté entendue comme un état n’existe pas. Il soutient cependant l’existence et la possibilité d’un mouvement de libération. Ses écrits en témoignent profondément.
Je repense à la « fenêtre du fantasme » évoquée par Lacan : l’homme ne voit la réalité qu’à travers la fenêtre de son fantasme – une petite lucarne, opaque d’ailleurs la lucarne, un minuscule vitrail aux formes et couleurs toujours singulières.
Côté fauteuil, dans la succession des séances et des discours qui se déroulent, il est parfois frappant d’entendre la diversité des mondes tyranniques : l’un étouffe dans un espace de plus en plus restreint par ses crises d’angoisse et d’agoraphobie, l’autre n’est plus qu’une des variables de son équation de calcul continuel des calories, une autre subit en tremblant les foudres et colères de son chef (étrange, il est vrai que sa mère entrait dans des rages imprévisibles, mais démissionner ? « non, vous n’y pensez pas, jamais je ne retrouverai un aussi bon poste… »), un autre se torture sans fin à la pensée d’une infidélité de sa femme, il y a dix ans… Les variantes se déclinent sans fin, elles aussi.
Combien d’entre nous subissent de plein fouet la tyrannie de leurs mécanismes psychiques, ou sont en lutte contre eux ? Quelqu’un y échappe-t-il ?
Faut-il être en lutte contre une tyrannie extérieure, pour échapper à ses tyrannies intérieures – ou seulement les mettre en sourdine ?..
Pourtant, pour peu que l’on s’accroche un peu, pour peu que l’on accepte qu’il y faut une certaine temporalité – cela prend du temps, de démêler les minces fils d’acier agglutinés en cordes qui nous enserrent et nous constituent à la fois -, s’ouvrent des espaces de liberté. Et il y a cette surprise de la liberté, encore et encore, qu’elle soit personnelle ou ressentie par un-e analysant-e. Tiens, quelque chose de nouveau est possible ! C’est assez incroyable, « je respire un peu ! ».
Deux questions :
- qu’est-ce qui est opérant ? quel scalpel tranche les fils d’acier ?
- quels espaces ?
Quel scalpel ?
La parole. Ou plus précisément un certain usage de la parole. Ou plus précisément encore ce n’est pas la parole elle-même, c’est un certain rapport à la parole.
L’art de l’analyste (il me semble…) réside dans son rapport à la parole, dans sa capacité à distinguer les différents plans de la parole, s’y repérer, s’y situer, entendre un peu de quelle manière l’analysant y est pris, et par ses interventions – interprétations (dans un certain contexte : un transfert sans dimension utilitaire[1]) permettre que la prise dans le langage devienne moins aliénante, que se creuse peu à peu l’espace d’un positionnement subjectif et désirant.
En ce sens l’image du scalpel est fausse : ce serait plutôt du dissolvant à effet très lent, qui dissout peu à peu des points de fixation, ce serait encore une forme de lubrifiant, qui aide à démêler des noeuds trop serrés, et de la patience à chercher à tâtons quels bouts de quelles cordes tirer, pousser, faire bouger et glisser, peu à peu…
Ce rapport particulier à la parole, qui distingue différentes formes et plans de langage, de parole et de discours, a pour nom « historique » l’inconscient freudien. Je le souligne souvent et le répète encore, il me semble que ce rapport particulier à la parole peut prendre d’autres formes et d’autres noms que la psychanalyse (autour de l’art, de la créativité, de l’inventivité et de la rencontre…). Dans le champ de l’analyse la dimension de l’inconscient freudien reste l’une des références essentielles, un repérage incontournable.
Les différents plans de la parole, qu’est-ce que cela veut dire ?
D’abord nous ne pouvons pas oublier (il me semble…) qu’au regard du réel la parole n’est que du vent (et le vent chante parfois un chant bouleversant, ou nous caresse et berce avec une douceur infinie, ou nous secoue de sa terrible violence), ou « au mieux » la parole se transforme en chimère, un être composite de mots et de réel, vent et matière opaque mêlés, lorsque la parole parvient à toucher à un peu de réel, à s’y ancrer.
Les différents plans de la parole : les mots s’agglomèrent en discours, un truc qui est censé avoir un certain sens, une certaine signification. Les effets d’un discours dépendent en grande partie de l’entité qui le profère, et de son positionnement dans le rapport « interhumain » : effets structurants des bouts de discours qui nous constituent (il faut bien arriver à se prendre pour soi-même, et un peu de matériaux pour le construire, ce soi-même), effets informatifs des connaissances partagées, enseignées, effets hypnotiques et/ou effets d’oppression du discours ambiant, du discours des figures d’autorité, quelles qu’elles soient.
Un discours n’a rarement qu’un seul type d’effet : les effets structurants, informatifs, hypnotiques et d’oppression se mélangent en proportions variables.
Le rapport particulier de l’analyste à la parole – il n’est pas le seul à pouvoir construire ce rapport particulier – relève d’une espèce de paradoxe intenable, à soutenir tout de même : la parole n’est presque rien (ce n’est que du vent, des chimères !.. la plupart de nos discours sont des leurres, ou des ritournelles que nous répétons, ou des délires, et ce que je suis en train de produire n’y échappe pas), mais sans parole (sous une forme ou une autre) nous n’existons pas. Sans parole nous ne nous rencontrons pas. Sans parole ne peuvent s’opérer les magies de l’humain, toutes ses formes de poésie. La parole, ancrée à certains endroits du réel de notre corps, raboutée dans notre chair (cf la « lalangue » de Lacan), est la matière même de notre existence d’humain, de sujet. La cure agit sur cette matière, et permet à l’analysant de la transformer.
La parole n’est presque rien, est tout, est un leurre, une ritournelle, un délire, les discours constituent, enferment, écrasent. À supporter de parler tout de même, à soutenir que « c’est de la parole / ce n’est que de la parole », à supporter d’écouter l’autre parler, se construit l’espace de la possibilité de la présence de l’un et de l’autre. Je peux exister, tu peux exister. Ni plus, ni moins…
Je peux exister, parler, t’écouter, nous échapperons peut-être à peu près aux effets d’oppression si nous y prenons garde, nous n’échapperons pas aux leurres, ritournelles, erreurs, délires, malentendus, mais j’aurai pu être présente (subjectivement) en ta présence, et inversement. Tu auras pu me faire entendre quelque chose de ta parole, de ta forme singulière d’existence, et inversement. Il y a un peu de magie dans ces effets de présence. Pouvons-nous plus ?
Quels espaces ?
Tous ou presque. Ce rapport particulier à la parole, où qu’il soit soutenu, permet un positionnement subjectif et désirant : je suis présent-e, je pense, je n’en pense pas moins probablement diverses « conneries », mais j’existe, et lorsque je parle, c’est mon discours. Ce n’est pas un discours qui détiendrait la vérité, ce n’est pas un discours d’affirmation du moi pour lequel je me prends, c’est de la parole.
Un tel positionnement a des effets jusque dans la mise en jeu des pulsions. Une liberté se dessine dans le corps et son « usage », sa mise en mouvement et son rapport aux autres. Un espace de liberté dans les gestes du corps, le timbre de la voix, le rapport à l’alimentaire, à la sensualité, aux désirs charnels…
Je n’en dirai pas plus – ce n’est que de la parole !..
- le transfert à un autre qui n’utilisera rien de vous, ne jouira en rien de vous (le contrat du paiement des séances en est une formulation : ce que l’analyste retire de ses séances se limite au paiement en argent, avec pour prime il est vrai quelque chose du côté du mouvement désirant. Il serait mensonger de prétendre qu’il n’y pas une forme de satisfaction dans la mise en jeu du « désir de l’analyste », lorsque la cure permet le mouvement vers une libération subjective et désirante de l’analysant). ?