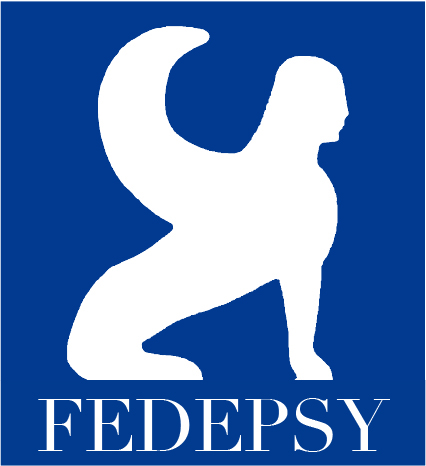Dans la rubrique « Par-chemins de l’Ecole », vous trouverez des échos des travaux de l’Ecole Psychanalytique de Strasbourg, et de ses modes de transmission, en particulier compagnonnage et témoignage.
« Le sens n’est nulle part. Nous le traçons avec de la fumée et le vent n’est jamais très loin. » Salah Stétié
Drôle d’aventure que ce deuxième témoignage qui amène à prétendre être analyste compagnon.
Étymologiquement, le compagnon est celui avec qui on partage le pain, comment partager le pain qu’a pétri l’expérience analytique ? Est-ce qu’être analyste compagnon c’est in fine, devenir co-pin ou co-pain avec l’analyste accompagné ? Certainement non.
Pour rester dans cette image, je dirais que la tâche de l’analyste compagnon est plutôt de prélever le levain de sa propre analyse pour permettre à celui qu’il accompagne de fabriquer son propre pâton. Certes, l’analyse nous met souvent dans le pétrin si vous me permettez le mot… Pourtant, ce levain qu’il s’agit de préserver, c’est, pour le dire avec Walter Benjamin, un « levain de l’inachevé ». Inachevé car le trajet de cette si exceptionnelle expérience se trouve toujours confronté, à un moment ou à un autre, à la butée du réel, à la rencontre avec un refoulé inatteignable. Il s’agirait donc de prélever sur le corps de notre propre expérience, un je-ne-sais-quoi qui permette à l’autre de trouver par lui-même jusqu’où il peut aller trop loin.
Je crois que dans le Talmud, il y a cette sentence que je cite de mémoire : « Ne demande jamais ton chemin à quelqu’un qui le connaît, tu risquerais de ne pas te perdre. »
Accepter de se perdre sur le chemin emprunté avec le compagnon, c’est, pour l’accompagné, renoncer à une demande de garantie. Nul analyste, aucune école ou institution, n’est, par essence, à même de garantir le travail d’un analyste. Pour autant, j’avancerais que c’est dans la façon de se soumettre à la contrainte d’un réel, en tant que le réel est ce qui reste impossible à symboliser, c’est dans la façon de se soumettre à cette contrainte que pourra se dessiner un chemin singulier. Je crois que le compagnonnage peut aider à préciser cet itinéraire, itinéraire qui est tout à inventer, et surtout, peut-être, à permettre à l’accompagné de saisir le moment de s’y précipiter.
Vaste programme !!!
Si l’on suit Lacan dans sa topique où se distinguent les trois instances du Réel, du Symbolique et de l’Imaginaire, la question qui se pose est dès lors de savoir comment s’appuyer sur les deux dernières pour approcher la première.
Victor Hugo soutenait : « L’âme a ses illusions comme l’oiseau, ses ailes : c’est ça qui la soutient. »
Il faut bien un minimum d’imaginaire pour symboliser le réel, c’est-à-dire qu’il faut bien partir de l’instance imaginaire qu’est le moi pour « l’éplucher » de ses identifications imaginaires, ces couches de moi-Idéal qui masquent, en le soutenant malgré tout, l’idéal du moi surgi de l’identification au trait unaire.
L’idéal du moi est le fruit de l’identification signifiante. « Suivez la rampe du signifiant » soutenait Lacan, et je m’autoriserais à rajouter : « Suivez la rampe du signifiant, suivez-la jusqu’à dénuder le moi et faire apparaître son cache-sexe. Mais là, restez très prudent, précautionneux, agissez (au sens d’interpréter) avec tact et délicatesse ».
C’est, pour moi une immense question technique, beaucoup plus que théorique. Je crois que là se pose la question de la rigueur avec laquelle est maniée la dimension transférentielle. Je dirais que c’est la perception de la consistance du transfert qui permet de savoir jusqu’où aller trop loin.
C’est là où notre position d’analyste nous enjoint de maintenir une distance vitale par rapport à notre propre fantasme fondamental. Une position d’éroménos – de celui qui est aimé – est intenable, l’analyste doit, plus que jamais dans ces moments de bascule du travail analytique, rester à sa place d’érastès, de désirant, pour permettre à l’analysant de se précipiter vers ce chemin évoqué plus haut.
J’avancerais que, en psychanalyse, son propre fantasme fondamental doit avoir, pour l’analyste, la place d’un secrétaire. On sait que Lacan disait que « le psychanalyste doit se faire le secrétaire de l’aliéné ». Eh bien je pense que ce fantasme fondamental est toujours là dans la pratique de l’analyste, toujours présent, car même traversé, il nous attire à nouveau dans ses filets, sauf que, à l’écoute de la mélodie signifiante, tout à coup une résonance surgit qui fait du secrétaire un secret à faire taire, un secret fondamental à mettre à terre. Dans le temps synchronique de la résonance, il faut le secret-taire et que le secret soit mis à terre. Mon propre fantasme n’est, bien sûr, pas sans lien avec cette redondance de jeux de mots.
Les mots, les mots et les images, voilà les deux outils dont dispose le vivant humain pour se représenter le monde et aller à la rencontre de l’autre.
Le génie freudien nous a montré que pour que cela soit possible, il était une condition primordiale, c’est que l’infans accepte de participer à ce monde de la parole et du langage qui lui est présenté. C’est par la grâce de cette Bejahung, ce oui originaire au langage, ce premier jugement, jugement d’attribution, que le petit d’homme pourra extraire de lui une once de jouissance, une jouissance « mauvaise » pour lui, pourrait-on dire. Ce rejet, cet Ausstossung, va faire accéder le parlêtre au principe de réalité qui est témoin d’un jugement d’existence.
La mythologie freudienne ne pouvait s’élaborer qu’en se référant à un autre mythe que Freud va trouver dans le mythe œdipien. C’est grâce au mythe d’Œdipe et à la loi symbolique articulée au langage qu’il introduit, que Freud pourra élaborer sa théorie de l’inconscient soutenue par les avatars pulsionnels, notamment le refoulement et la sublimation.
Lacan, en fouillant de manière exhaustive, le déchiffrage freudien, va nous pousser plus loin que ce que Freud a nommé le complexe d’œdipe. Il va faire du mythe œdipien, un symptôme et même le symptôme de Freud ! Il théorise la métaphore du signifiant du nom-du-père et avec elle, il nous révèle un au-delà du complexe d’œdipe, un au-delà des deux dimensions du symbolique et de l’imaginaire, il nous révèle un réel relevant de l’impossible.
Dans son ouvrage, Un mystère plus lointain que l’inconscient, Alain Didier-Weill nous montre d’une manière éblouissante, la fécondité qui existe à s’adresser au mythe de Dionysos pour aborder ces questions du réel, de l’impossible et de la résonance évoquée plus haut.
Dionysos est le dieu de l’excès, de l’outrance, de la fête. Il meurt et ressuscite périodiquement, rythmiquement selon Alain Didier-Weill. C’est le dieu de l’apparition et de la disparition qui se répètent indéfiniment. Il nous renvoie à la dimension de la jouissance, une jouissance qui rythme notre existence, qui la structure en la rythmant.
C’est cette attente et la perspective d’une nouvelle apparition/disparition qui habite le parlêtre (on ne peut qu’évoquer à ce propos le jeu du fort-da du petit-fils de Freud) et peut donner au psychanalyste cet enthousiasme à propos duquel Lacan écrit à ses collègues italiens : « S’il n’en est pas porté à l’enthousiasme, il peut bien y avoir eu analyse, mais d’analyste aucune chance. » Enthousiasme, nous rappelle A D-W, cela veut dire « endieusement », l’enthousiasme de l’analyste serait l’endieusement par Dionysos.
Je crois que nous touchons là à une dimension capitale du compagnonnage qui est cette transmission d’un enthousiasme à s’engager dans un chemin qui n’est pas tracé. Excusez-moi de rappeler ces vers bien connus d’Antonio Machado : « Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. » « Toi qui chemines, il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. »
Mais se reconnaître dans cet enthousiasme proposé, cela demande une grande exigence. Les différentes écoles et institutions analytiques travaillent à interroger en permanence la théorie et la pratique analytiques, certaines d’entre elles cèdent, à mon sens, à une « lacanolâtrie » qui peut virer parfois au dogmatisme. Cela me paraît inconvenant du moins par rapport à ma modeste culture psychanalytique et à ma pratique déjà ancienne. J’ai travaillé depuis fort longtemps les textes de Lucien Israël et j’ai trouvé que l’EPS et l’enthousiasme de Jean-Richard Freymann évitaient cet écueil redoutable.
Il n’empêche que les travaux de ces écoles constituent des bases théoriques de référence, indispensables, très fécondes, mais qui, pour un analyste, peuvent se poser comme des lois écrites dont il ne faudrait pas s’écarter. Mais, de même que le chemin n’est pas tracé, ce qui se joue dans une séance n’est jamais écrit, et la fécondité de l’acte analytique n’est le fruit que d’une seule chose : le désir de l’analyste, le maintien de cette position d’érastès que j’ai évoquée il y a un instant. Ce désir de l’analyste, j’avancerais qu’il est le fruit de la certitude d’une ignorance. Certitude dynamisante, motrice, dont le manque-à-être est le témoin. Certitude que tout sujet « recherche indéfiniment ce qui n’existe pas » (Valéry). Certitude que son réel le plus intime est pour toujours inaccessible. Le désir de l’analyste c’est ce qui, sans cesse, « porte la soif plus loin que l’oasis » (François Cheng).
L’interprétation relèvera toujours d’une urgence, pressée par le désir de l’analyste.
J’avancerais qu’il y a aussi un temps logique dans le travail analytique. Il y a l’instant du regard, qui serait la saisie d’un S1, d’un signifiant-maître, puis un temps pour comprendre où toutes les connaissances théoriques et les données de l’expérience propre de l’analyste sont mobilisées, et le moment de conclure qui se fait toujours dans l’urgence, dans la hâte d’une énonciation qui n’est que le témoin de la rencontre de deux « manque-à-être ». Il y a là urgence à quitter la loi écrite de la théorie pour la loi non écrite qu’impose à chaque Un le réel du manque-à-être. C’est une perte de jouissance qui s’actualise.
La littérature peut, peut-être, nous aider à imager cela.
Les ouvrages de Philip Roth nous plongent dans des monuments de jouissance décrits de la façon la plus crue. Cette jouissance est celle de l’auteur lui-même, mais tout au long des livres que j’ai pu lire de cet auteur, même si le caractère autobiographique reste évident, le style de la narration maintient une distance salutaire par rapport à cette jouissance. Sont ainsi amenées, je crois, à la fois une jouissance débridée et une distance, un défaut de jouissance imposée par une narration qui inclut le manque-à-être. Je trouverais cela également dans l’œuvre de Samuel Beckett avec la même précision narrative et la même distance par rapport à la narration.
Ces deux immenses écrivains sont, pour moi, des témoins géniaux de ce procès permanent que constitue la dynamique aliénation/séparation dans la genèse du sujet de l’inconscient. Je dirais, de manière trop laconique, que l’aliénation à la jouissance de l’Autre doit se délivrer d’un éclat de jouissance qui permet que, de la séparation qui en résulte, surgisse une part d’âme sans… illusion…
Cela nous ramène à la problématique de toute rupture. Lorsque survient une rupture, elle ne peut se faire que dans la hâte. Elle n’est en fait que la solution qu’a trouvée un sujet dans le temps pour comprendre, mais c’est au moment où elle devient certitude, certitude anticipée de la liberté ainsi dévoilée, qu’elle impose ce caractère d’urgence. Le lion ne bondit qu’une fois nous rappelle Freud. Il faut savoir mettre le pied dans la porte pour l’empêcher de se refermer…
Je voudrais, pour conclure, interroger la question du compagnonnage dans ce que l’on pourrait appeler sa dimension sociale.
Lacan disait de la psychanalyse qu’elle est une pratique sociale. Ceci nous amène à questionner ce qu’est le lien social, quelle en est sa texture et en quoi la psychanalyse peut-elle y participer. C’est bien évidemment une question sur laquelle on ne peut répondre en quelques lignes. Toutefois je pense que l’on peut amener quelques idées, quelques pistes de réflexion.
Il est paradoxal, même si cela devient un truisme de le rappeler, que notre époque qui a, comme cela n’a jamais été le cas dans l’histoire, des possibilités stupéfiantes de transport de l’information, soit désormais confrontée à tant de souffrances liées à l’isolement des individus.
Je ne vais pas reprendre la problématique des quatre discours magistralement élaborée par Lacan. C’est bien sûr le permanent mélange de ces quatre discours qui rend compte du lien social.
Je vais un instant, pour y revenir ensuite, quitter la psychanalyse, pour reprendre une distinction fondamentale à mon sens, et je me réfère là aux travaux du philosophe Régis Debray, distinction entre communication et transmission. Pour cet auteur, communiquer c’est « transporter une information dans l’espace », à la différence de transmettre qui se définit comme « transporter une information dans le temps ». Je crois que cette distinction nous permet une approche de ce qu’est le lien social actuel. Communiquer, c’est comme cela se dit souvent : « transporter une information en temps réel ! », même si ce qualificatif est bien obscur, cela nous montre que dans le monde de la com. c’est la loi du tout et tout de suite qui s’impose. À rebours s’il s’agit de transmettre une information, se pose consubstantiellement la question du temps, du délai, de la « differance » pour parler comme Derrida.
Bien sûr, la question du tout de suite ne se pose plus dans ce cas, mais ce qui est capital à mes yeux, c’est que la notion du tout de l’information est aussi invalidée.
Pour moi, la transmission impose une perte, il y a une part manquante dans l’information qui est transmise. J’avancerais que c’est cette perte qui peut permettre le maintien d’un lien social solide. Cela parce que cette part manquante (titre d’un très beau livre de Christian Bobin récemment disparu) traduit la singularité, la différence absolue qui existe entre le transmetteur et celui qui reçoit le message. On dit qu’en prescrivant, le médecin se prescrit lui-même, eh bien je crois qu’en transmettant, le transmetteur est lui-même dans ce reste qui ne se transmet pas !!!
Ce reste, cette perte, j’avancerais qu’ils sont le fait de la dimension poétique du langage, de l’équivocité signifiante et de l’incapacité définitive du langage à recouvrir la totalité du réel. Cette part manquante dans la transmission nous renvoie bien entendu à la dimension de l’inconscient et à une jouissance refoulée. Le monde de la communication c’est le monde où règne la jouissance, le temps de la transmission c’est le temps du désir. L’animal humain a cette particularité dans le champ du vivant de pouvoir transmettre autre chose que des gènes ou des comportements. Très souvent, ce qu’il transmet, il le transmet sans le savoir, et c’est sûrement ce qui le rend profondément humain et par là, à même de faire du lien.
Cette digression sur le lien social n’est bien sûr pas sans rapport avec le compagnonnage que propose l’EPS. C’est cette dimension capitale du manque-à-être, d’une jouissance impossible de la totalité de l’être, qui doit à mon sens, accompagner l’analyste en gésine.
Bibliographie
Alain Didier-Weill, Un mystère plus lointain que l’inconscient, Aubier, 2010.