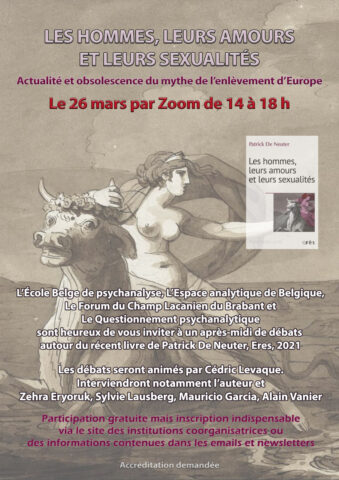Préambule…
…à l’usage de ceux qui se demandent ce que c’est, mais il ne sera pas répondu à la question, bien sûr. Il ne sera pas dit « ce que c’est ». Il ne peut pas être dit « ce que c’est », comme il ne peut être dit ce qu’est l’homme. Ou alors, à ce qu’il peut en être dit, manque l’essentiel, le p’tit truc insaisissable et essentiel.
Je pense qu’on ne comprend pas – « on », non-analyste s’entend, et peut-être analyste aussi –, qu’on prend cela pour du baratin. Et on a raison. Bien souvent moi non plus je ne comprends pas. C’est un peu comme une porte magique ; une formule magique est prononcée, la porte apparaît et s’ouvre, le monde entier s’ouvre, s’anime, se déplie, a une épaisseur. Soudain la porte est refermée : le monde est plat, une étendue sans fin et sans saveur. Et je ne peux la rouvrir, la porte, et je ne peux la retrouver, et presque je ne me souviens plus qu’elle peut exister. Ce n’est pas de la magie, c’est l’humain. Le désir, lorsqu’il est libéré un peu de ses attaches aux objets, est une étincelle qui se répand dans le monde entier et l’anime.
La psychanalyse permet, parfois, souvent peut-être si l’on en respecte le temps, d’ouvrir la porte magique, qui n’est pas magique, la porte de l’humain, la porte du désir, pas le désir « pervers » ou « perverti » des objets fétiches ou fétichisés ; le désir qui porte l’être humain, l’anime, le fait exister, le fait vivre, le fait danser sa vie.
Il n’y a pas que la psychanalyse à permettre cela. Il y a l’art, les arts, et certains savent trouver, créer l’étincelle jusque dans l’art de vivre.
La psychanalyse permet de tout petits changements, qui changent tout. Un petit décalage de rien du tout, qui transforme l’esclave de son quotidien en la même personne, qui d’ailleurs fait à peu près la même chose, à quelques détails près qui là encore changent tout ; la même personne à ceci près qu’elle est vivante, existante.
C’est compliqué parce que je n’ai pas le choix, je dois dire que « si l’on n’a pas expérimenté cela on n’a pas idée de ce que c’est », et je sais bien que cela semble être l’argument fallacieux par excellence.
Si l’on n’a pas expérimenté cela, on n’a pas idée de ce que c’est.
Expérimenter qu’une porte peut s’ouvrir, et alors du souffle, du mouvement, un pétillement à l’intérieur de soi. Expérimenter que la porte se referme parfois, trop souvent ; à tâtons on cherche à la retrouver, on ne sait pas, on ne sait plus, une porte, quelle porte ?
Il ne sera pas dit « ce que c’est » ; que ceux qui vraiment ne supportent pas de sortir du domaine de ce qui se mesure, s’évalue, se raisonne, que ceux-là ne se fatiguent pas trop. Mais ceux-là, vraiment, n’aiment-ils pas quelqu’un, quelque chose, ne sont-ils pas touchés, d’une façon ou d’une autre, par une des manifestations de l’humain ? la musique, la danse, la peinture, le cinéma, la poésie, l’être aimé, que sais-je, ce qu’ils voudront bien ? et pensent-ils vraiment que ce qui les touche se réduit à ce qui s’en mesure ? vraiment ? que l’être humain se réduit à ce qui de lui se mesure ?…
Mais je peux « comprendre » – au sens de partager – leurs barrières, leurs craintes, leurs impasses : il y a une pente de la pensée vers le rationnel. Notre pensée nous mène à de telles créations, à partir de la raison ; tout ce que l’être humain a bâti, grâce à la logique et aux sciences !… À commencer par sa propre vision du monde. Notre pensée s’est coulée dans les formes du rationnel, de la logique, cela lui réussit si bien, d’ailleurs. Il y a tant de domaines dans lesquels c’est efficace, efficient.
Mais l’humain… l’humain, cela échappe.
Une des formules magiques qui fait réapparaître et se rouvrir la porte – formule magique pas tout à fait contrôlée – correspond à ces moments où je formule ma pensée sans essayer de la comprendre, de la saisir, de tout saisir. Illusion que de saisir tout à fait quoi que ce soit, dans le domaine de l’humain. En dire quelque chose, oui – « mi-dire », disait Lacan –, mais saisir, rien du tout. Comme il devient possible de parler de « quelque » chose – la psychanalyse, par exemple – lorsque je renonce à la saisir. Un mouvement naît en moi, se creuse, un souffle qui me porte et porte une parole.
Qu’est-ce que c’est que la psychanalyse ?
Question impossible… surtout ne pas essayer d’y répondre.
À chaque retour d’absence, de vacances – vacance, un peu d’espace vide, « libre », enfin – lorsque je reprends mes consultations et séances, je re-démarre, je re-commence. Et souvent quelque chose se formule, s’éclaire, dans les recommencements. Quelque chose s’éclaire, dans « ce que je fais » à recevoir et écouter des personnes toute la journée ; qu’est- ce que c’est que ce truc, qu’est-ce qui s’y passe, quels sont les ressorts de ce qui s’y passe, les ressorts de la possibilité qu’il se passe quelque chose… Quel est l’outil, l’instrument,
comment se manie-t-il, quel geste de maniement, quel acte, quel effet, que vient opérer l’outil, que vient-il ouvrir, découper – l’outil, que pourrait-il être d’autre que la parole, et son possible « tranchant »?
Ce qui s’éclaire aujourd’hui, l’idée d’ « animer ». Je vous rassure, aucun écho à de quelconques animations de vacances dans un quelconque centre de vacances tout compris – ce n’est pas trop mon style de vacances/vacance… Mais « animer » : donner de l’âme… pas de mysticisme non plus, pas de grande révélation religieuse pendant mes vacances, pas d’apparition ni d’hallucination, me semble-t-il ?… Mais l’humain, le spécifiquement humain, le subjectif, « exister en tant que sujet », cela ne s’attrape dans aucun tamis rationnel, cela ne se prend dans aucun miroir aux alouettes, c’est un souffle, quelque chose comme un souffle. La psychanalyse est tout de même l’un des moyens pour un sujet de trouver ce souffle, de creuser la brèche par laquelle il peut émaner, s’échapper, enfler, et tendre les voiles…
Animer, donner de l’âme… c’est-à-dire prendre le contre-pied de toutes les pentes naturelles sur lesquelles glisse la pensée humaine : pentes qui d’ailleurs avant d’être des pentes sont les moyens nécessaires à créer un monde et le rendre viable.
Je m’explique : le sujet, ou peut-être devrais-je dire le « sujet potentiel », celui qui peut exister de manière subjective, qui porte en lui cette possibilité comme une virtualité non accomplie, ce sujet avant « d’exister » est surtout articulé par de multiples rouages auxquels il ne peut pas grand-chose, voire à vrai dire rien, ni ne comprend grand-chose, voire rien.
L’être humain se construit et construit l’idée de son individualité et de son identité dans le monde, et construit le monde, sa vision du monde, à travers sa prise dans le discours des autres ; autres parentaux, le discours de l’Autre, les discours ambiants, le discours courant. Prise du sujet potentiel dans le discours, les discours, et prise dans les pulsions, pulsions des autres et ses « propres » pulsions. Rouages complexes, montage invraisemblable.
« Prise » à entendre encore dans le sens où « prend », par exemple, la gelée de framboises en refroidissant : le sujet, virtualité de sujet, est confit dans les discours, les fantasmes et les pulsions – dont on ne sait pas s’ils sont de l’Autre, ou du sujet, ou à l’intersection des deux… J’ai goûté à de meilleures confitures que la confiture de sujet.
Il me semble important d’entendre ce que cela veut dire : les mécanismes en jeu, là, sont l’hypnose par le discours courant et le discours de l’Autre, l’automatisme dirigé par le discours lui-même (et sa structure signifiante), et par les fantasmes et par l’aiguillage, la vectorisation par les pulsions, la prise du « sujet » comme objet dans les jeux de pulsion et de pouvoir.
Je ne sais pas si vous entendez cela, et ses conséquences, et à quel point l’idée de
« liberté », par exemple, est là le leurre le plus complet, le comble de l’illusion. L’être humain, dans sa vie de tous les jours, ses grandes et petites décisions, et indécisions, ses amours et sa carrière professionnelle, est le jouet d’un montage complexe d’automatisme,
d’hypnose, et de la résultante des forces vectorisées du jeu des pulsions et rapports de pouvoir.
Mais non, n’est-ce pas, « moi, je sais ce que je fais et je fais ce que je veux… » bien sûr… (comme diraient mes enfants : « c’est ça, oui… et la marmotte, elle emballe le chocolat dans le papier alu…1 »).
Le sujet, exister en tant que sujet, ce serait une brèche dans tout cet édifice. Un endroit où grippent les rouages, où manquent quelques dents de quelques roues. Une pensée, un choix, un acte, qui par cette brèche échappent à la mécanique hypnotisante, à l’hypnose automatisée. La psychanalyse permet cela. Et permet d’ailleurs, à l’usage, lorsque l’analysant dans sa cure a fait un bout de chemin, à l’usage permet une certaine usure des rouages ; permet qu’une brèche reste ouverte, et que de cette brèche émane un souffle, un mouvement intérieur, subjectif, différent du mouvement grinçant des rouages, un mouvement intérieur capable de porter le sujet.
Cela s’appelle le désir. Un désir particulier, non collé à un objet fétichisé, non bouché par son objet fétichisé – les désirs « habituels » sont de l’ordre de ces collages aux objets, ceux de notre monde « marketinguisé » : « rien ne va dans ma vie ni dans ma tête, mais je vais m’acheter une nouvelle paire de chaussures, et tout ira mieux… » (Et si par hasard vous n’y pensez pas vous-mêmes, vos mails vous le diront.) Un désir libéré de ses entraves aux objets fétiches, fétichisés, fétichisants. Un désir humain…
Cela s’appelle l’inspiration, aussi…
Animer, « donner de l’âme », ce serait permettre la brèche, permettre le souffle. Entendre dans la parole de l’analysant (et du patient, hors analyse à proprement parler) ce qui n’appartient pas à la ritournelle du discours courant, ce qui n’est pas la répétition hypnotique automatisée : les endroits où ça parle, ça parle du sujet. Entendre cela, indiquer, remarquer, souligner, interroger cela. Alors peuvent se faire entendre, peu à peu, sur des années parfois, souvent, peuvent se faire entendre les points fixes auxquels sont vissés les rouages grinçants de ce sujet en particulier. Et cela met un peu de jeu, un peu de souplesse, dans l’écrasant engrenage.
« Donner de l’âme » est un peu faux, donc l’analyste ne « donne » pas. Mais l’analyste peut être sur la longueur d’onde du souffle, du mouvement subjectif, du désir humain, réhumanisé, réhumanisant. Et cela permet à l’analysant, un jour où l’autre, de se laisser porter par son propre mouvement désirant. Un peu, beaucoup, passionnément…
Passer de la confiture au souffle. Je ne déplierai pas l’idée ici, lui laisserai ses relents de fruits sucrés et d’airs maritimes ; en quelques mots, il s’agit de passer du plein, trop-plein, à la possibilité d’un peu de perte, perte « supportée », un peu d’espace, un peu de manque qui fera appel d’air et fera naître le souffle…
Il n’y a pas d’Autre (de l’Autre) ? Il n’y a pas d’autre ?
Un autre aspect encore, dans ce qui s’éclaire par le contraste absence-retour après les vacances, re-commencement. L’autre ; l’Autre. Le mouvement désirant, le souffle, est une affaire de solitude, et de solitude radicale. Personne d’autre que vous ne portera votre mouvement. L’Autre n’existe pas. L’Autre, celui qui viendrait garantir quelque chose, quoi que ce soit, celui qui viendrait assurer, rassurer, n’existe pas. Il n’y a pas de garantie dans la vie. Il n’y a pas d’assurance-risque, ni d’assurance-vie. Rien que des mots, cela, des mots bien choisis pour voiler une absence. Solitude radicale, absolue.
Pourtant il y a des rencontres. Des personnes autour de nous, certaines, une ou quelques rares unes, sans lesquelles comment respirer ? Sans leur parler, sans qu’elles nous parlent, comment maintenir ouvert le monde, comment y faire jaillir une étincelle ?
Parmi les rencontres, une forme particulière de rencontre, celle d’un analyste.
Est-il possible vraiment de trouver du souffle, seul ? Est-il possible de trouer la gelée de framboises, de la fissurer pour s’en extirper, sans l’adresse à un autre (Autre ?) qui a déjà troué sa gelée ?
L’Autre n’existe pas, mais est-il possible d’exister sans l’adresse à un autre qui existe ?
Je m’arrêterai sur ces concepts métapsychologiques complexes et pointus : gelées, souffles et confitures…
1 Référence déjà un peu datée à une certaine publicité : certains se rappelleront, et les autres… mangeront du chocolat. Ce qui est encore un moindre mal…